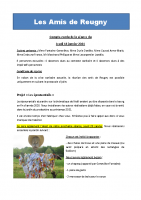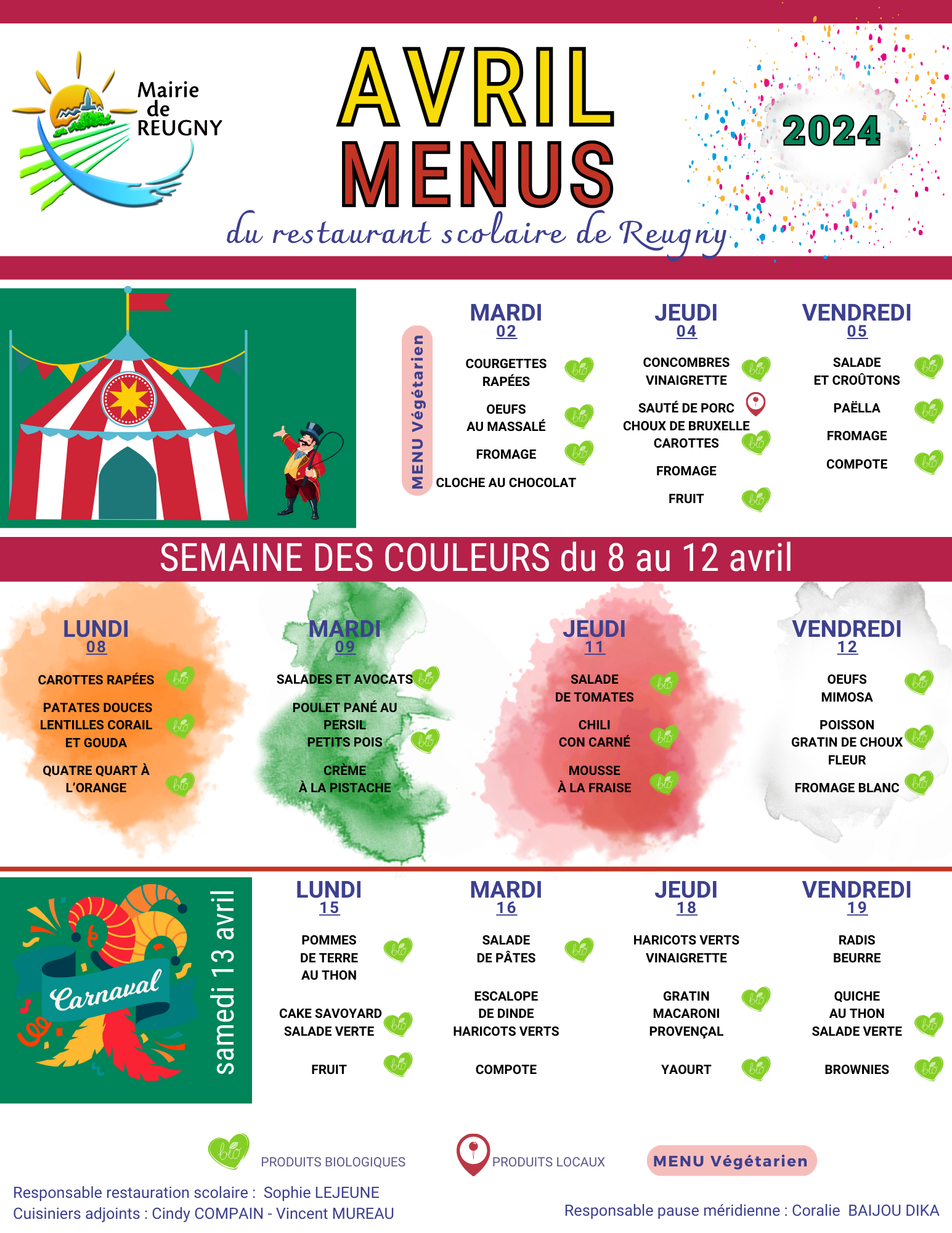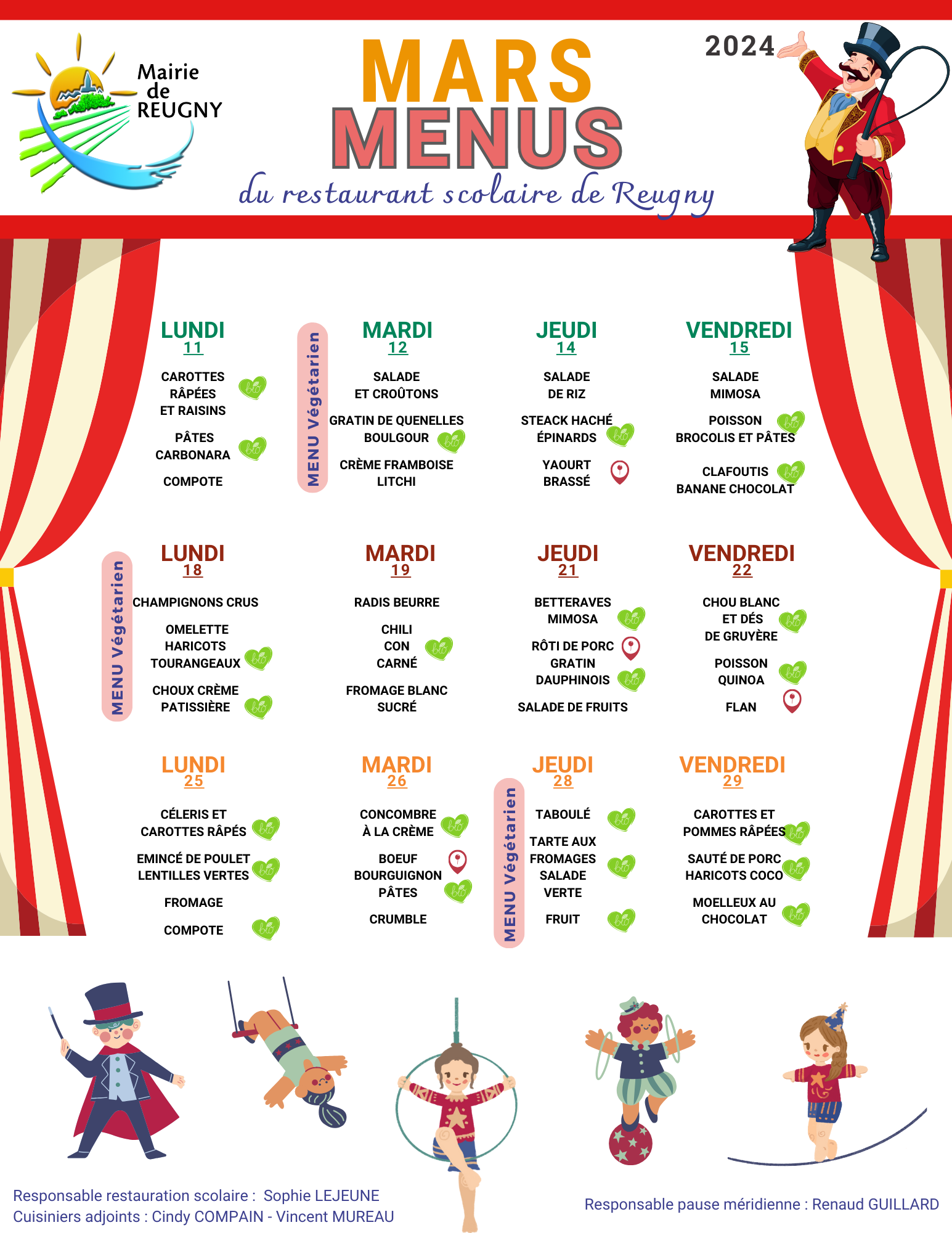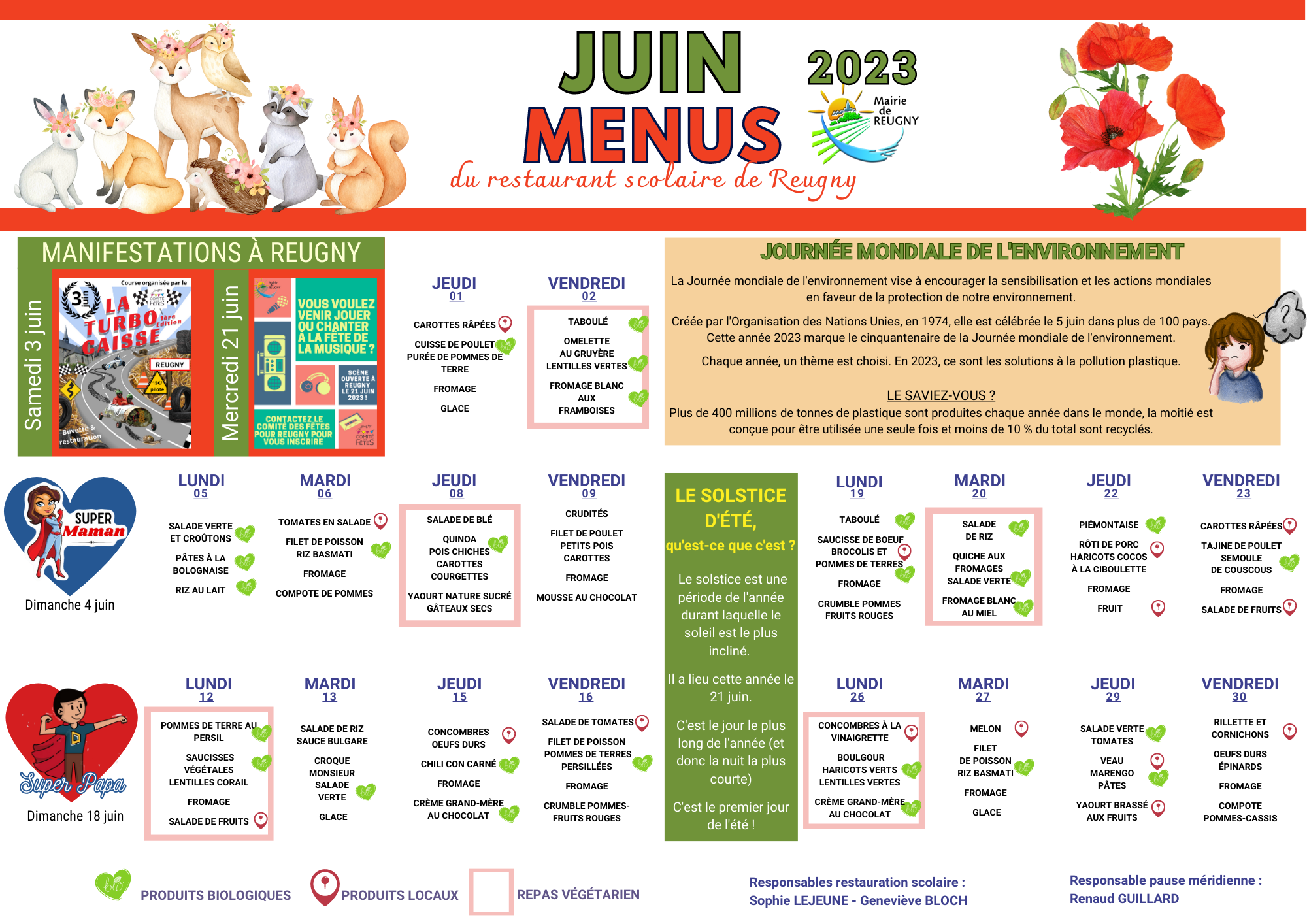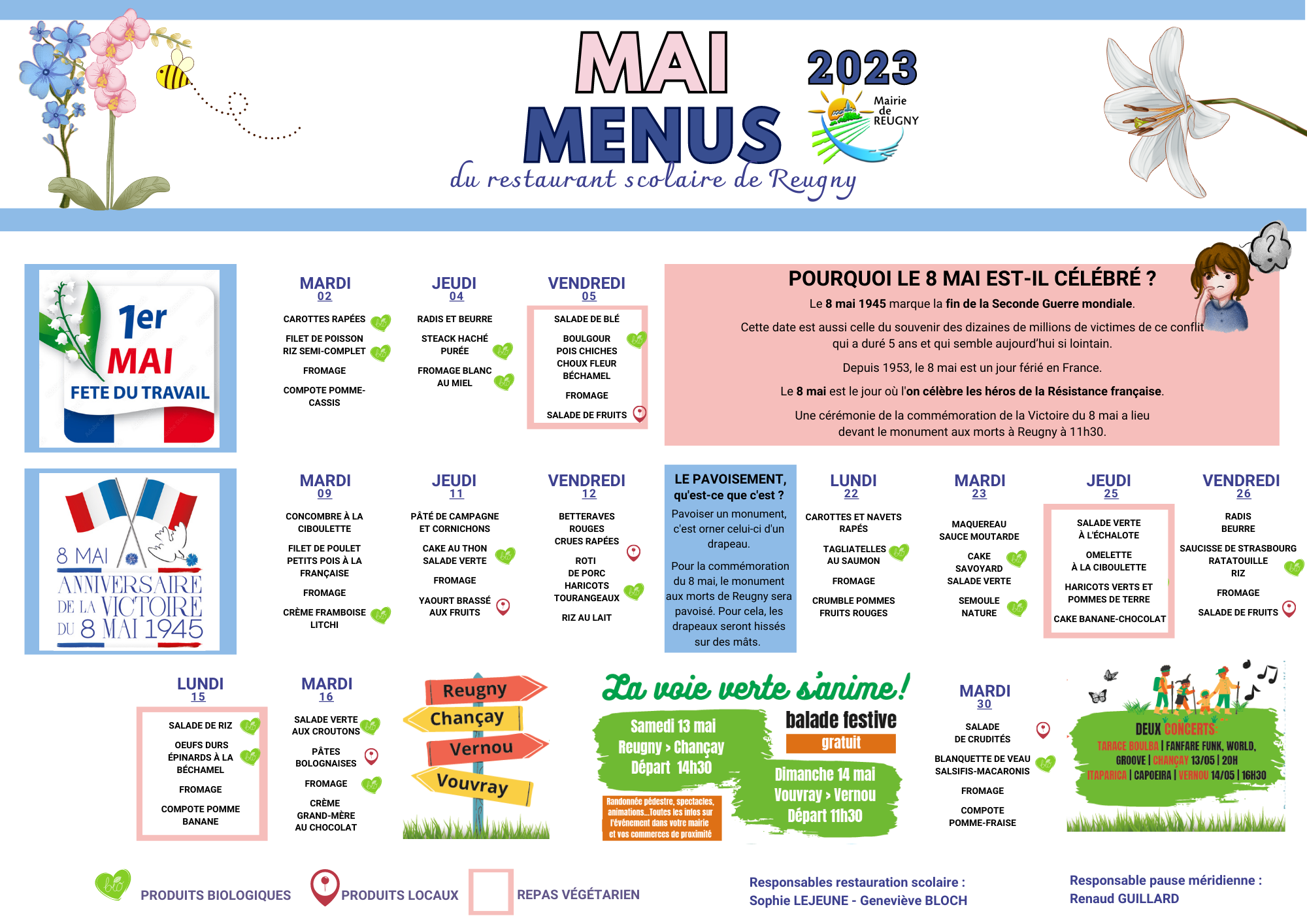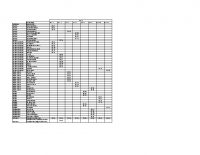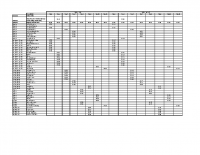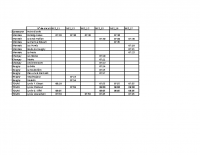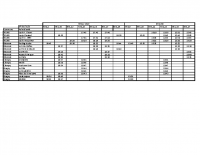AIDES AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES – FRANCE SERVICES
NOUVEAU DEPUIS JANVIER 2022
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec internet ?
Les espaces France Services sont là pour vous accompagner.
Le service est gratuit et confidentiel.
Vous pouvez prendre rendez-vous :
à Vouvray – Tél : 02.46.99.04.90 (Espace Simone Veil, 25 Rue des Ecoles)
à Monnaie – Tél : 02.47.56.10.20 (Mairie de Monnaie Place Charles de Gaulles)
RÉSEAU DE SOUTIEN AUX AIDANTS FAMILIAUX
CONFINEMENT ET VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES
ASSISTANTE SOCIALE – A COMPTER DU 1er JANVIER 2017
MAISON DEPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITE
1 Rue Beauregard
37110 CHATEAU RENAULT
Tél. 02.47.29.50.94
Mme BROSSARD assistante sociale du secteur est présente en Mairie SUR RENDEZ-VOUS le 2ème et 4ème vendredi de chaque mois de 10 h 30 à 11 h 30.
DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL :
Le département recrute : FAMILLE D’ACCUEIL
POLE EMPLOI
http://www.pole-emploi.fr/accueilpe/
Tél. 3949
EMPLOIS EN TOURAINE, SITE de TOURAINE LE DEPARTEMENT : jobtouraine.fr
 job-touraine
job-touraine
SERVICES A DOMICILE
ASSAD – Association de Soins et Services A Domicile
25 Rue Michel Colombe
37029 TOURS Cedex 1.
Tél. 02.47.36.29.29
ADMR
22, rue Fernand Léger
37000 TOURS – 02.47.36.53.53
Responsable Secteur :
Mme DEMOUSSIS
Tél. 02.47.36.53.53
A.S.E.R.
Association Service Emploi
Aides pour le repassage, ménage, travaux d’entretien intérieurs et
extérieurs…
3 Rue Félix Nadar—37100 TOURS
Tél : 02.47.51.70.70
ASSISTADOM
Services à Domicile – 28 Rue Victor Hérault – 37210 VOUVRAY
Tél : 02.47.40.00.59
PRESENCE VERTE
Téléassistance 24 h/24h – 37 Rue Michelet – 37000 TOURS
Tél : 02.47.31.61.96
HANDI’CHIENS
 handichiens
handichiens




 job-touraine
job-touraine